Quand la fiction fait l’évènement en passant pour le réel : retour, sous forme de feuilleton, sur près d’un siècle de faux-semblants radiophoniques, ces fictions qui se font passer pour le réel. Dans l’après Deuxième Guerre mondiale, en l’absence de panique médiatique notable, nous avions cru un instant qu’ils avaient disparu. En réalité, ils se transformaient. Nous atteignons maintenant la fin du 20e siècle : la mue s’achève, le faux-semblant s’institue lentement comme genre reconnu.

Illustration issue de la revue Sciences du Monde n°95 de novembre 1971
Dans les années 1970 et 1980, les faux-semblants s’enfouirent comme pour mieux préparer leur futur déchaînement. On note bien, ici ou là, quelques scandales locaux : un dimanche de février 1972, par exemple, une cinquantaine de personnes appelèrent les commissariats de Los Angeles pour requérir urgemment l’intervention de la police. L’Alaska, Tokyo, l’ouest des États-Unis et le Canada venaient de sombrer dans l’océan. La catastrophe, mise en ondes par la radio KPPC FM de Pasadena, était présentée comme la conséquence d’un essai nucléaire bien réel mené par les États-Unis dans l’île aléoutienne d’Amchitka le 6 novembre 1971. Cannikin, la bombe employée, disposait d’une puissance 385 fois supérieure à celle d’Hiroshima, ce qui faisait de ce test la plus forte explosion nucléaire jamais déclenchée par le pays. Les écologistes avaient alerté sur la survenue possible de tsunamis ou de tremblements de terre. Seules des secousses modérées avaient finalement suivi, mais l’impact dévastateur de la déflagration avait été publiquement dénoncé : des milliers d’oiseaux, d’otaries et d’autres mammifères furent tués ; une crique disparut purement et simplement ; les prélèvements biologiques opérés dans les mois qui suivirent sur les habitants et habitantes d’une île voisine montrèrent des niveaux de radioactivité anormalement élevés, sans qu’aucun suivi médical ne fût pour autant institué par les États-Unis. Durant deux heures, KPPC FM avait rendu le cataclysme palpable de façon plus concrète pour le public californien. Celles et ceux qui manquèrent l’avertissement initial, rendu obligatoire par la Federal Communications Commission depuis l’épisode de La Guerre des mondes, connurent quelques sueurs froides1. En mars 1980, au Canada cette fois, la radio CJAV de Port Alberni en Colombie-Britannique reconstitua avec réalisme, pendant 35 minutes, l’irruption d’un tsunami en 1964. Une coupure de courant généralisée ayant coïncidé, quoique très brièvement, avec la diffusion, quelques auditrices et auditeurs de la région entreprirent qui de garer son véhicule en hauteur, qui de quitter le travail pour rejoindre sa famille2. Dans les tous derniers jours de décembre 1985, enfin, des Finlandais et Finlandaises crurent, selon la presse, le troisième conflit mondial arrivé, une pièce étatsunienne intitulée The Next War (La prochaine guerre) ayant mis en scène, avec tous les préavis nécessaires quant au caractère fictionnel de la diffusion, une attaque nucléaire entre les États-Unis et l’URSS3.
Hormis ces infimes tempêtes, un grand calme régnait sur le front des faux-semblants radiophoniques. Dans les années 1990, cependant, leur vague monta doucement. Elle déferlerait dans les années 2000. Pour l’instant, on observait l’institution de deux grandes catégories de simulacres radiophoniques : ceux qui faussaient l’histoire et ceux qui tournaient le présent en dérision. Ou, pour reprendre une typologie établie par le philosophe Jean-Marie Schaeffer, les « feintises sérieuses » et les « feintises ludiques », que Christophe Deleu, chercheur en histoire de la radio et lui-même auteur de divers docu-fictions, caractérise ainsi dans le champ de la création radiophonique : « Le docufiction de type feintise sérieuse vise à tromper l’auditeur, à faire passer le faux pour le vrai. Au contraire, le docufiction de type feintise ludique ne cache pas son caractère hybride et vise à entraîner l’auditeur dans un espace indéterminé, aux frontières incertaines (la feintise est partagée, l’auditeur est prévenu du mélange des genres)4. » Pour les secondes, évoquons d’emblée un programme qui connut un grand succès médiatique et reçut plusieurs récompenses en Grande Bretagne : la série People Like Us (Les gens comme nous), écrite par John Morton et diffusée sur BBC Radio 4 de 1995 à 1997, avant de se décliner à la télévision. L’émission jouait avec les codes du reportage, sa visée s’annonçant ouvertement divertissante. Dans chaque épisode, le reporter Roy Mallard (joué par Chris Langham) suivait, en alignant les gaffes et les absurdités, le quotidien d’un·e Britannique ordinaire au travail : fermier, agent immobilier, médecin, mère au foyer, photographe… Caricature du journalisme de proximité, People Like Us dressait un portrait caustique de la société britannique de la fin du 20e siècle5.
People Like Us, 2ème saison, épisode 4, « The Estate Agent » (l’agent immobilier), BBC Radio 4, 26 juin 1996.
Gregory Whitehead, Pressures of the Unspeakable, ABC, 1992.
Pour rester dans les feintises explicites mais du côté cette fois de l’art radiophonique et non de la comédie (quoique cet art ne fût pas exempt d’humour, loin s’en faut), citons le travail de l’étatsunien Gregory Whitehead, producteur de « performances documentaires », selon ses propres termes. Whitehead, chez qui « il semble toujours y avoir quelque chose à deviner entre le non-sens et le non-dit »6, édifia dans les années 1990 plusieurs institutions imaginaires dans le domaine acoustique : l’Institut international de recherches sur le cri, l’Institut mémoriel Paul Broca pour le comportement schizophonique ou encore le Laboratoire d’innovation et de recherche acoustique. Le premier faisait partie d’une plus vaste supercherie : en tant que directeur autoproclamé dudit Institut, il avait mené un travail en résidence au sein de la radio publique australienne ABC, mettant en place une Salle de cris et un Numéro national du cri (sur le répondeur duquel les appelant·es pouvaient déposer leurs spécimens), et prenant part à diverses présentations officielles de ses expérimentations. À l’issue du projet, il avait produit la pièce Pressures of the Unspeakable (Pressions de l’indicible), Prix Italia en 1992, entremêlant les vociférations, acclamations, lamentations et hurlements recueillis avec de savantes réflexions sur le cri formulées lors de ses interventions publiques. Quant au Laboratoire d’innovation et de recherche acoustique (en anglais le Laboratory for Innovation and Acoustic Research ou LIAR, « menteur/se »), il avait donné lieu à plusieurs pièces sur le réseau étatsunien NPR, sous forme de monologues in situ, mixés avec de discrètes compositions électroacoustiques. En 1997, Ice Music présentait ainsi très doctement une nouvelle technique de congélation des sons. Whitehead mena ensuite, sur BBC Radio 4, des « conversations imaginaires », échanges très sérieux sur des probématiques scientifiques fictionnelles, mais non moins subtiles, toujours entremêlés de thèmes musicaux.
Questionnement poétique du langage, satire de l’expertise, invention littéraire, création radiophonique et musicale, l’œuvre de Whitehead bâtissait bien réellement, en brouillant les frontières conceptuelles et formelles, une étude scientifique et philosophique par des moyens artistiques. Le faux-semblant interrogeait ici non seulement les représentations médiatiques, les légitimités établies, les pratiques instituées, les catégories de vrai ou de faux, mais aussi, philosophiquement, le grand théâtre de l’existence. L’imposture artificielle, annoncée comme telle, venait se confronter à cette imposture majeure du monde en tant que tel : dans ce que nous acceptions comme la réalité, au fond, qu’y avait-il d’authentique ?
« Selon Gregory Whitehead, la substance fondamentale de la radio, ce n’est pas le son (contrairement à la conception que l’on en a habituellement), mais c’est l’espace entre la transmission et l’audition. », écrit l’artiste sonore Coraline Janvier7. Le faux-semblant travaillait l’acte même d’émettre, rompait le flux constant d’assertions, ouvrait une brèche éphémère dans l’agglomérat du réel. Et il devenait un genre à part entière, décliné sous de multiples formes.
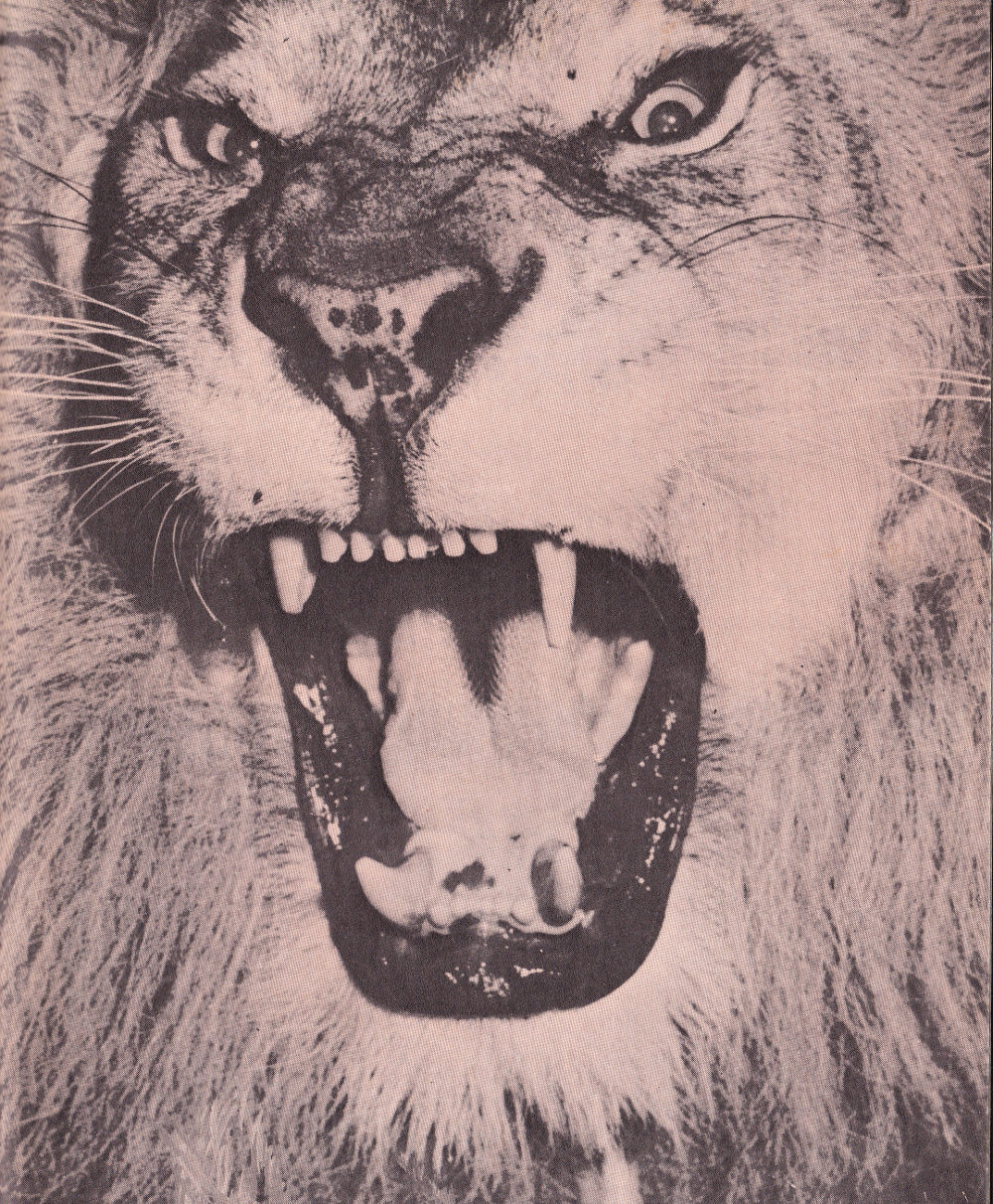
Illustration issue de la revue Sciences du Monde n°95 de novembre 1971
Dans ces années 1990, en France, plusieurs feintises sérieuses virent le jour. Sérieuses, c’est-à-dire qu’elles ne s’annoncèrent pas comme telles, maintenant la mystification de l’indicatif de début à celui de fin. L’ambiguïté de la première fut telle, à vrai dire, qu’elle se refusait, même a posteriori, à dire si elle relevait ou non du docu-fiction. En 1991, les Nuits magnétiques diffusaient Et Vermeer a marché, un documentaire de Simon Guibert et Alexandre Héraud8. Les deux producteurs s’y mettaient en scène, le premier entreprenant de vendre un tableau, potentiellement de Vermeer, à la demande de sa grand-mère, et le second souhaitant acheter le tableau pour son père. La pièce se présentait comme un reportage dans les coulisses du marché de l’art ancien, de l’expertise jusqu’aux enchères, où intervenaient plus ou moins fortuitement des proches des producteurs eux-mêmes. Une narration en voix off de Guibert et Héraud, très littéraire, faisait le liant entre les scènes enregistrées in situ, apportant des considérations personnelles sur la commercialisation des œuvres. Christophe Deleu conclut : « La mise en abyme fonctionne ici jusqu’à la fin de l’émission : de la même façon que les auteurs et les experts s’interrogent sur l’identité du peintre du tableau (est-ce un Vermeer ?), l’auditeur peut se demander s’il écoute une vraie émission documentaire (à qui appartient le tableau ? sa vente a-t-elle bien lieu ? ne sert-elle pas uniquement à explorer le monde des marchands de tableau ?)9. » Cela deviendrait plus tard une caractéristique fondamentale pour toute une branche de faux-semblants : peu importait la véracité des situations, seules comptaient leur vraisemblance et, surtout, la qualité des réflexions qu’elle suscitaient. Le public devait désormais accepter de ne pas savoir, de ne pas se focaliser sur les classes du documentaire et de la fiction – c’était du moins ce qu’on attendait de lui. Il ne s’agirait plus pour les auditrices et auditeurs de déjouer un canular, pas davantage de se divertir d’une habile mise en scène, mais d’appréhender cette nouvelle représentation du réel comme une façon parmi d’autres – plus riche, plus pertinente, plus complexe – de transmettre des connaissances et des analyses. Le contrat d’écoute conventionnel, assignant le documentaire à l’authenticité et la fiction à l’imaginaire, se voyait profondément remis en question.
« Nuits Magnétiques, bonsoir… », documentaire de Christophe Deleu et Anna Szmuc, Sur les docks, France Culture, 3 septembre 2013.
Boucherie, documentaire de Gérard-Julien Salvy et Bernard Treton, Nuits magnétiques, France Culture, 24 janvier 1980.
Nul hasard si l’émission qui amenait cette petite révolution se trouvait être les Nuits magnétiques, créées en janvier 1978 par Alain Veinstein : on y revendiquait une approche subjective, tâtonnante, vivante de la parole, traitant pareillement l’intervenant·e anonyme et la personne célèbre ; on y travaillait une radio non de journaliste mais d’auteur et d’autrice, en faisant appel à des écrivains et écrivaines ; on y explorait de nouvelles formes, « où la réalisation devait jouer un rôle déterminant »10. Mehdi El Hadj, l’un de ses réalisateurs réguliers, y avait produit sous pseudonyme, en 1980, un documentaire en plusieurs parties autour des affabulations. Des mensonges en hiver11 proposait une foisonnante immersion dans les univers de faussaires, mythomanes, nègres littéraires, imposteurs et imposteuses, de l’adultère au mensonge d’État.
Interview de Medhi El Hadj par Christophe Deleu, France Culture, 2013.
Le cadre de diffusion de la seconde feintise sérieuse, le 4 avril 1991, ne laissait pas suspecter la possibilité d’une fiction. L’émission Une vie une œuvre commençait sur France Culture et, comme à son habitude, elle prenait la forme d’un entretien en plateau entre son producteur, Noël Simsolo, et un spécialiste, autour de la biographie d’un grand homme ou d’une grande femme, le tout agrémenté d’archives historiques et d’interventions enregistrées d’autres expert·es12. Le grand homme, en l’occurrence, se nommait Aimé Honoré Fortuné Désiré de Vaugelaere et avait pratiqué, dans sa Belgique natale, divers arts, du théâtre à la peinture. Quoiqu’il parût avoir rencontré toute l’intelligentsia culturelle et scientifique de son époque (son carnet d’adresses ne comprenait pas moins de 3 784 entrées), on disposait de très peu d’informations à son propos et Une vie une œuvre offrait une discussion avec l’auteur d’un futur essai sur de Vaugelaere pour y remédier. Durant une heure et demie, des propos cultivés s’échangeaient ainsi, sur un ton tout à fait naturel. On s’extasiait sur les aphorismes de l’illustre inconnu (notamment son plus frappant, « Halte à l’immobilisme ! ») ; on passait des extraits de ses pièces de théâtre (jouées avec une outrance on ne peut plus réaliste) ; on rivalisait d’érudition et d’analyses percutantes (« Finis ton rouge avant qu’il vire au vert », avant de devenir un bon mot de bistrot, revêtait une signification picturale profonde, liée aux pigments de couleur). Nous étions trois jours après le 1er avril, de Vaugelaere n’avait jamais existé. Noël Simsolo et ses invités, Pierre Olivier, Cyril Robichez et Michel Cazenave, avaient réussi une belle performance, démontrant, si besoin était, que l’on pouvait sans mal forger une vie de toutes pièces au moyen d’archives mensongères, de faux entretiens et d’un cadre à même de légitimer l’ensemble.
Une édition d’Une vie une oeuvre consacrée à Alfred Jarry, animée par Noël Simsolo et Jean-Claude Loiseau, France Culture, 8 juillet 2007.
Des indices réguliers furent semés au fil des échanges sous forme de blagues raffinées, de subtilités burlesques, mais l’assurance des intervenants et la réputation de sérieux de l’émission l’emportaient sur les exagérations volontaires : la biographie factice se montrait tout à fait crédible. Elle jetait même, contre son gré, un trouble sur le dispositif habituel du programme, en faisant ressortir l’entre-soi mondain et la routine lettrée. On se divertissait entre esprits éclairés. Se posaient néanmoins là les bases de plusieurs autres faux-semblants qui émergeraient dans la grande vague des années 2000, injectant de la fiction non plus dans des reportages à rebondissement ou de trépidants flashs d’information, comme les pièces qui avaient fait scandale par le passé, mais sur des plateaux très pondérés et dans des documentaires diffusés en différé, qui avaient explicitement fait l’objet d’un méticuleux montage. La mystification investissait des formats plus policés, moins susceptibles jusqu’ici de prendre ces libertés.

Illustration issue de la revue Sciences du Monde n°95 de novembre 1971
En 1998, Sonia Kronlund proposait sur France Culture une série estivale intitulée Le corridor étoilé, qu’on ne connaît actuellement qu’à travers un descriptif : « Cinq nuits propices au contact avec les subtils parfums du songe éveillé. Cinq nuits d’essais radiophoniques pendant lesquelles le récit et son cortège d’images sonores viendront se mêler aux formes usuelles de la radio. Conversations d’utopies, conte en reportage, poème documentaire, enquête fiction ou entretiens monologues.« Bernard Treton réalisait Une journée au bord du trou noir, le « conte en reportage »13. Un jour, dans « un village du Centre presqu’oublié », un trou noir sans fond s’était soudain creusé. Une fois la panique initiale passée et après la fuite d’une partie des habitant·es, la mairie décidait de transformer le trou en attraction touristique. Dans Je me souviens de Jim Box, Nicole Salerne menait quant à elle l’« enquête fiction » sur une amie imaginaire inventée par sa sœur dans son enfance14.
L’Escamoteur escamoté, un documentaire de Michel Pomarède réalisé par François Teste (Une histoire particulière, France Culture, 1er janvier 2017), où les auteurs travaillent de nouveau autour de la disparition, de la quête, de l’imaginaire.
Dans une approche comparable, en 1999, les Nuits magnétiques diffusaient Détective. Le métier à filer de Michel Pomarède et Vincent Decque15. Pomarède introduisait l’émission en annonçant : « J’entame un nouveau chapitre. Mon roman se prolonge. Aujourd’hui, j’avance masqué pour mener l’enquête. L’enquête, c’est découvrir qui est l’autre, mon double. J’ai choisi trois personnages qui filent pour moi la métaphore d’une muse. Son nom est Pénélope. » La suite mêlait des entretiens bien réels et une investigation fictionnelle sur l’usurpation d’identité dont aurait alors été victime Camille Laurens. Cette dernière, autrice chez POL, et Éric Laurrent, auteur aux éditions de Minuit, évoquaient leur rapport à l’écriture et à l’imaginaire, se transformant parfois en protagonistes de la fiction radiophonique ; Jean-Jacques Parenti, détective lui-même, répondait à des questions sur son travail, tout en se prêtant au jeu de la fausse enquête. La fiction et le documentaire se croisaient en permanence, les séquences de la filature imaginaire incluant des moments d’interview ou de reportage conventionnels. En voix off, Michel Pomarède commentait l’évolution de l’intrigue autour de l’usurpation d’identité. Il tissait par ailleurs un niveau supplémentaire dans la narration : la quête, sous forme de micro-trottoirs, de Pénélope, personnification mythologique de la ruse et de l’esquive.
La pièce proposait ainsi une réflexion sur les parallélismes entre littérature et investigation, mais jouait également sur le thème du double, « chaque protagoniste [semblant] à un moment ou à un autre prendre l’identité ou la profession de l’autre »16 : le producteur se faisait romancier, la romancière détective, et le détective réel, privé de fiction policière. Le public, de son côté, devait s’initier à l’écoute caméléon, adaptant sa perspective auditive en fonction des incessants changements de plan. Le faux-semblant gagnait en complexité, usant d’artifices inventifs et de détours volontairement déconcertants. Il ne se donnait plus pour objectif de construire le récit le plus réaliste possible, mais, au contraire, de faire éclater les cadres de la narration.
Notes :
1 Non signé, « Radio Show Starts Panic », Gettysburg Times, 8 février 1972 ; Jeffrey St. Clair, « The Bomb That Cracked An Island », Counterpunch, 27 septembre 2013. 2 Non signé, « Radio Show On Tidal Wave Creates Panic », The Free-Lance Star, 29 mars 1980. 3 Non signé, « Listeners In Finland Panick At A-Attack On Radio », Toledo Blade, 30 décembre 1985. 4 Christophe Deleu dans « Dispositifs de feintise dans le docufiction radiophonique », Questions de communication, n° 23, 2013, pp. 293-318. Il s’appuie sur les concepts développés par Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction ?, Paris, Le Seuil, 1999. 5 Coraline Janvier, « Qui est vraiment Gregory Whitehead ? », Syntone, 20 janvier 2014. 6 Ibid. 7 Simon Guibert (producteur), Alexandre Héraud (producteur), Mehdi El Hadj (réalisateur), Les Nuits magnétiques, « Et Vermeer a marché », France Culture, 7 mars 1991, fonds Ina. 8 Christophe Deleu, Le documentaire radiophonique, Paris, co-édition Harmattan / Ina, 2013, p. 220. 9 Alain Veinstein dans le documentaire de Christophe Deleu et Anna Szmuc, « Nuits Magnétiques, bonsoir… », Sur les docks, France Culture, 3 septembre 2013. 10 Mehdi El Hadj (producteur), Jeanne Folly, Pamela Doussaud, Nuits Magnétiques, « Des mensonges en hiver », 25, 26, 27, 28 et 29 février 1980, fonds Ina. 11 Noël Simsolo (producteur), Jean Claude Loiseau (réalisateur), Une vie une œuvre, « Aimé de Vaugelaere », 4 avril 1991, France Culture, 4 avril 1991, fonds Ina. 12 Bernard Treton (réalisateur et producteur de l’émission), Sonia Kronlund (productrice de la série), Le Corridor étoilé : Une journée au bord du trou noir, France Culture, 24 août 1998, fonds Ina. Les citations sont extraites du descriptif de l’émission sur le site de l’Ina. 13 Nicole Salerne (réalisatrice et productrice déléguée de l’émission), Sonia Kronlund (productrice de la série), Le Corridor étoilé : Je me souviens de Jim Box, France Culture, 10 août 1998, fonds Ina. 14 Michel Pomarède et Vincent Decque (producteurs), Colette Fellous (coordinatrice), Nuits magnétiques, « Détective. Le métier à filer », 17 février 1999, France Culture, fonds Ina. 15 Deleu, Le documentaire radiophonique, op. cit., p. 224.
Cet article est d’abord paru dans le n°8 des Carnets de Syntone. Abonnez-vous par ici pour recevoir nos articles en primeur !

