Chant d’amour filial pour une mère qui s’absente, journal intime d’un drame en cours, Les mots de ma mère s’est imposé comme un des documentaires les plus marquants de ces dernières années. De l’ACSR de Bruxelles en 2015 à France Culture, en passant par le Prix Europa ou le récent concours Phonurgia Nova(*), l’œuvre d’Aurélia Balboni a toujours suscité une adhésion doublée d’un respect souvent ému. D’évidence, cette capacité à inclure son public dans le secret d’une histoire douloureuse, sans tomber dans le voyeurisme ou le morbide, requiert une maîtrise rare. On le pressent aux frissons que procure son écoute, on touche là à l’essence de la radio de création. En suivant le fil de quelques mots-clés, en voici une lecture subjective.
Démence
Plasticienne et directrice d’un centre d’art contemporain récemment licenciée, Françoise Gibert souffre d’une perte de mémoire sémantique, une maladie neurodégénérative qui touche aux connaissances générales (le langage, les concepts). Elle oublie les mots, devient incontrôlable et capable de comportements burlesques (repeindre la voiture des autres en rouge, s’introduire dans une maison et confisquer les clés) ou dangereux (traverser les routes de campagne). Non consciente de son mal, elle perd le sens de la réalité. Aurélia Balboni, sa fille, ne dresse pas vraiment le constat clinique de la maladie, mais esquisse un quotidien qui se consume, et dont elle est aussi une protagoniste. Une tragi-comédie, vécue de l’intérieur.
Rayures
« Ma mère s’est mise à peindre sur ses tableaux ». C’est l’histoire d’un basculement. Celui d’une femme en souffrance, certes, mais aussi de ses enfants : d’une époque à une autre, où plus rien ne sera comme avant. Un temps (le passé créatif) disparaît sous un autre (le présent destructeur, porteur d’un futur angoissant). L’insouciance de la jeunesse s’efface au profit du vieillissement, de l’inquiétude, des responsabilités. L’artiste en roue libre qui rajoute des couches de peinture (sacrilège !) recouvre une réalité par une autre. Elle raye son existence passée et brouille les repères de chacun·e, badigeonnant de son ingénuité nouvelle les codes de la normalité.
Dépossession
La vie de Madame Gibert est de plus en plus étriquée : on lui a retiré son permis de conduire, on l’a interdite de bus, des cadenas apparaissent sur certaines portes. Tandis que son champ sémantique s’amenuise, son espace vital se restreint, d’autant plus qu’elle est surveillée par tout le monde, dont la police. Par petites touches, Aurélia Balboni excelle à dépeindre le sentiment de perte, de dépossession. Elle suggère l’enfermement progressif par la répétition de certains motifs – au sens musical du terme. Du Vivaldi écouté en boucle et en solitaire, les grattements du fusain sur la toile, l’obsession pour la voiture et la liberté qu’elle procurait, les coups de téléphone qui dessinent un nouvel horizon relationnel (présence/absence, distances accrues). Les contours d’un univers psycho-géographique qui se réduit comme une peau de chagrin.

Une femme folle, Eugène Delacroix, 1822
Foi
Enregistrer les errements de sa propre mère, leur donner une forme radiophonique et les diffuser sur des stations publiques ou lors de festivals réputés dépasse l’idée même de courage – ou d’inconscience. Trouvant son point d’équilibre entre pudeur et impudeur, la démarche de la jeune autrice témoigne surtout d’une foi inébranlable dans la noblesse du média radio. Moins invasive et vorace en spectaculaire que l’image, la radio se nourrit de distance, de zones d’ombre et se montre capable de laisser l’imagination se substituer au silence. On devine dans Les mots de ma mère, en filigrane, cette idée que tout peut s’enregistrer si l’on trouve ensuite la formule juste et digne. Aurélia Balboni semble aussi accorder une grande confiance dans la qualité de réception de celles et ceux qui, s’ils/elles écoutent, comprendront – sans doute – sa tentative.
Le geste plutôt radical d’une autrice que rien n’appelait, aucune nécessité collective, aucun appel extérieur.
Métamorphose
Ni documentaire social, sociétal ou politique, Les mots de ma mère est un projet éminemment personnel, aux ressorts intimes. Le geste plutôt radical d’une autrice que rien n’appelait, aucune nécessité collective, aucun appel extérieur. Ce qu’il nous donne à entendre n’aurait pas dépassé la sphère du privé et n’existerait pas pour nous si la documentariste n’avait décidé de le consigner. C’est tout autant cette prise de risque que cette croyance dans l’effet cathartique de la création radiophonique qui en fait sa beauté. Comme si la métamorphose en objet sonore de ce drame familial allait automatiquement le rendre populaire, universellement écoutable. L’espoir d’Aurélia Balboni était visiblement de composer une œuvre à la fois dérangeante et pas si choquante, qui ferait reculer quelques tabous et barrières morales (la maladie n’est pas une honte) et avancer le savoir commun.
Distance
Comment s’approcher d’une « démente sémantique », comment écouter un drame latent ? La question posée par Les mots de ma mère est celle du regard, donc de la distance. Et plus prosaïquement, de la distance par rapport au micro. Aurélia Balboni a choisi un dispositif de « radio-vérité », enregistrant telles quelles les scènes du quotidien, et s’incluant elle-même comme agent opérant. Montage et réalisation sonore sélectionnent et donnent du liant à l’ensemble. On entend donc beaucoup la voix de l’autrice au premier plan. Celle-ci donne leur impulsion aux conversations, avec bien sûr l’intention de faire perler, mot après mot, phrase après phrase, la source sonore qui va lui « parler ». Mais ce qui exsude de ces séquences – au moins telles qu’elles nous sont restituées –, c’est une douceur filiale infinie, une patience d’ange. Et surtout un respect qu’aucune faute du goût attentatoire à la dignité de la mère ne vient déflorer. La voix de Florence Gibert, elle, apparait plus insaisissable. Elle volette entre plusieurs plans, plusieurs pièces, s’approche et s’éloigne. L’empreinte sonore d’une instabilité, d’un bouillonnement intérieur. À plusieurs reprises, la mère désigne le micro et interroge : « C’est quoi ça ? », sans avoir conscience ou, peut-être, niant la finalité de cette présence. Un effet de réel – on ne vous cache rien, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes dans la vérité du moment – et une mise en abyme efficaces, avec lesquels Aurélia Balboni n’occulte pas la question du consentement final, et donc de la responsabilité. Une affaire de morale, donc, qu’elle laisse à l’appréciation de chacun·e. L’acte de créer, semble-t-elle dire, demande parfois à jouer avec les convenances, à ne pas respecter toutes les règles. Sous peine d’être trop conforme ou même de ne pouvoir exister.
Voix off
Pour inscrire son œuvre dans une réalité plus dense et variée, Aurélia Balboni multiplie, sans ostentation, les techniques radiophoniques. Lecture de courrier médical, conversations téléphoniques, gros plans sur le glissement d’un pinceau sur la toile, panorama plus large avec clocher et chants d’oiseau, dialogues entre sœurs et frère pris sur le vif, zones de silence… Une large palette qui lui offre la possibilité d’une composition soignée et d’une attention à la portée de chaque son. Mais le choix le plus marquant s’avère cette voix off avec laquelle l’autrice, sur un débit assez placide et sans émotion apparente, raconte des épisodes non enregistrés et relate la sévérité croissante de la maladie. Si son utilité narrative semble incontestable, on devine vite que cette voix joue le rôle d’un filtre face à la brutalité de l’histoire et à l’inconfort de sa relation à sa mère. Une pause, avec laquelle Aurélia prend de la hauteur et se met à l’abri : elle devient à ces instants-là « la conteuse », celle qui sait et se souvient.
Répétition
Ne pas verser dans la sensiblerie, l’émotion facile. Deux séquences, parmi d’autres, bouleversent. Dans un renversement de l’ordre naturel, la fille réapprend le langage à sa mère, car il faut renommer les choses. « Là, c’est quoi ? – C’est un feutre. » Radiophoniquement très forte aussi, puisqu’elle passe à la fois par la langue et la sonorité, la lente mais inexorable désagrégation de la parole de Madame Gibert. Dans la première partie du documentaire, les mots sont légèrement flottants, soumis à l’impulsivité d’une logique impérieuse et désarçonnante. Puis la voix, peu à peu, change de modulation : plus aiguë, elle parait plus oppressée, plus heurtée. Elle se caractérise sur la fin par la répétition des derniers mots de chaque phrase : la pensée se heurte à son propre écho. De cet émouvant vortex sonore, on comprend qu’il permet à cette mère qui s’en va de lutter, par le surplus, contre l’impensé du documentaire : la disparition, le silence.
- Les mots de ma mère (2015, 52 min.). Réalisation et prise de son : Aurélia Balboni. Montage : Mathieu Haessler, Christophe Rault, Aurélia Balboni. Mixage : Philippe Charbonnel. En co-production et avec l’aide de l’acsr et Cinétroupe asbl.
- (*) Récompenses : « special commendation » du Prix Europa 2015, premier prix Radio aux Premios Ondas 2015, prix Scam France 2016 de l’œuvre radiophonique de l’année, prix Archives de la parole, Concours Phonurgia Nova 2016.

Cet article est d’abord paru dans le n°8 des Carnets de Syntone. Abonnez-vous par ici pour recevoir nos articles en primeur !

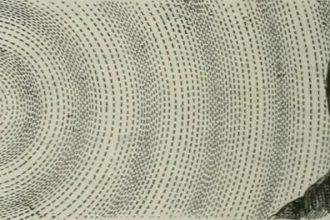
Émouvant,hors du temps , du socle de l entendement,mais,si vrai.