Pour une histoire culturelle du podcast
Un vent de fraîcheur, une nouvelle vague, le début d’un âge d’or, une renaissance, que dis-je : une révolution ! L’enthousiasme qui anime le milieu du podcast francophone s’est visiblement transmis, ces derniers mois, aux médias qui le couvrent. Ce, d’autant plus aisément que le milieu du podcast et celui des médias se recoupent : le premier accueille nombre d’exilé·es du vieux monde radiophonique et journalistique, tandis que dans le second, ceux qui ne maniaient jusque là que l’écrit et la vidéo se sont depuis peu avisés de l’existence du son. Une révolution gagnante-gagnante en somme. Mais une révolution qui, pour asseoir sa légitimité, prend un soin particulier à oublier le passé et à brouiller le débat. De l’invention il y en a, mais pas forcément chez celles et ceux qui crient le plus fort, et elle ne date pas d’aujourd’hui. S’il est réjouissant d’assister à une ouverture du paysage de la production sonore, à un questionnement de ses formes et à un intérêt nouveau pour elle, il reste fondamental de ne pas perdre pour autant – voire refuser – toute mémoire sonore.
Savez-vous qu’il existait en France dès 2005 une cérémonie des Podcasts d’or ? Que la même année, l’on trouvait déjà des articles de la « grande presse » pour s’émerveiller du potentiel de cette nouvelle pratique, en même temps que des billets de blogs qui craignaient que le podcast amateur ne soit sur le déclin ? Que l’on s’étripe depuis tout ce temps sur ce qu’est et n’est pas le podcast ? Que la rediffusion sur Internet d’émissions de radio remonte à une vingtaine d’années ? Que les premières fictions sonores réalisées exclusivement pour le web datent de l’an 2000 ? Et même, que l’on écoutait des histoires mises en scène ou des informations sur son téléphone il y a… cent trente ans ? Tentative impossible de définition du podcast et contribution à son histoire culturelle.

Joe Shlabotnik, « Radio Free Jones Beach », CC by.
Les légendes du podcast
L’histoire du podcast en France, si l’on en croit les récits actuels, se résume essentiellement à deux dates : à l’automne 2002, Arte Radio créa le premier site de podcasts francophones, se présentant, à l’époque, comme « une radio à la demande » ; puis, à partir de 2016, plusieurs sociétés spécialisées ou médias généralistes décidèrent de tout miser sur le son en ligne. Entre les deux ou avant cela, rien. Une histoire, exception française oblige sans doute, centrée sur une approche créative. Et qui semble essentiellement faire cas du podcast depuis qu’il a acquis une dimension économique, expérimentant les contenus payants, intéressant des publicitaires et investissant les médias de masse (notamment Canal+, avec le feuilleton apocalyptique Calls de Timothée Hochet, joué par plusieurs grands noms du cinéma). C’est ainsi que dans les deux dernières années, de multiples personnes ont annoncé à la ronde avoir inventé qui la « série sans images », qui la « comédie audio », qui l’« enquête sonore », qui le « festival de podcast natif ». Les émissions de plateau, pour paraître nouvelles, sont devenues des « talks », et les fictions comme les documentaires, des « histoires » – un double hommage au podcast anglophone, dont les causeries conviviales en public et le storytelling intimiste font figure de modèles financiers et éditoriaux (la qualité du contenu se trouvant pour une large part mesurée, néanmoins, à sa capacité à trouver un public nombreux).
La légende étatsunienne du podcast remonte un an plus loin et, surtout, se veut plus technique. Elle raconte que le podcast est né aux États-Unis de trois pères, les « podfathers » : Dave Winer, qui contribua au développement des flux RSS et y inséra le premier fichier son en 20011 ; l’ancien journaliste de presse, radio et télévision Christopher Lydon, devenu blogger, et que Winer convainquit en 2003 de diffuser via RSS une série d’entretiens audio qu’il avait réalisé avec diverses personnalités2 ; et l’ex animateur d’une émission musicale télévisée Adam Curry, qui développa la même année un logiciel afin de transférer des fichiers sons sur les tous nouveaux lecteurs portatifs d’Apple, les Ipods, puis fonda l’année suivante l’un des premiers podcasts de masse, le Daily Source Code3. Quant au terme lui-même, il fut suggéré en 2004 par le journaliste du Guardian Ben Hammersley, qui s’interrogeait sur la façon de nommer cette « révolution à écouter », comme il l’appelait déjà : « “Audioblogging”, “Podcasting”, “GuerillaMedia” ? »4.
Design sonore, de Cédric Chabuel, l’un des tous premiers sons mis en ligne par Arte Radio, en septembre 2002.
Calls, de Timothée Hochet et Norman Tonnelier : la création indépendante de 2016 qui a décidé Canal+ à produire la série du même nom un an plus tard.
Le « podcast », avec sa double référence à l’Ipod (offrant une écoute numérique, individualisée et mobile) et au broadcast (la diffusion centralisée de sons ou de vidéos par un media de masse), l’emporta – même en France, où l’on aurait pu opter pour la « baladodiffusion » québecoise, évocatrice d’une écoute décloisonnée5. Toujours en 2004, le site podcastalley.com inaugura le recensement des multiples podcasts qui émergeaient alors. En 2005, Apple, qui n’avait pas été particulièrement engagée dans le développement de la pratique et avait tenté, en vain, de se réserver la propriété du mot « podcast » après qu’il eut commencé à être employé couramment6, ajoutait à son logiciel musical Itunes une fonction de lecture de programmes sonores issus du web et sortait Garageband, un programme de montage audio, entérinant ainsi le caractère grand public de la diffusion mais aussi de la fabrication de fichiers sonores numériques. À défaut de l’avoir inventé, elle proclama triomphalement : « Apple Takes Podcasting Mainstream »7 – soit à peu près : « Apple fait entrer le podcast dans la cour des grands ». Un adoubement comparable, avec un peu moins de retard, à celui que Google vient d’opérer en annonçant en avril 2018 l’ajout d’un onglet dédié à l’audio dans son moteur de recherche8, ainsi que d’autres fonctionnalités visant à « faire du podcast un citoyen à part entière ».
Le Daily Source Code d’Adam Curry, le 21 août 2004 [lien direct du mp3].
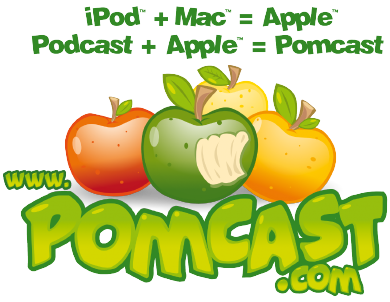 Logo d’un podcast de Stuff Mc débuté en 2005. Écouter le Rendez-vous Création du 14 juillet 2006 avec lui.
Logo d’un podcast de Stuff Mc débuté en 2005. Écouter le Rendez-vous Création du 14 juillet 2006 avec lui.
« Podcasts & Nous édition 6 : avec Henry Michel » (aujourd’hui pilier du label de podcasts Riviera Ferraille), par le Podauditeur le 8 août 2006.
Ces récits linéaires, avec héros, nouvelles technologies et grandes marques, simplifient singulièrement le passé, ne retenant de l’histoire que la perspective des vainqueurs : ils proposent, au fond, une chronologie capitaliste de la croissance du podcast. Mais avant d’y revenir, évoquons d’abord leurs mérites. Ils offrent une définition structurée du podcast, reprise par les productrices et producteurs indépendants de la jeune génération aussi bien que de celle qui a lancé la pratique en France il y a une quinzaine d’années. Le podcast se présente alors comme la mise à disposition de fichiers sonores inédits sur Internet à travers un flux RSS (lequel permet de recevoir automatiquement les nouvelles émissions et de les télécharger). Autrement dit : du son, créé pour le web, délivré gratuitement à travers un mode de distribution ouvert et faisant partie d’une série (on s’abonne à – et, en amont, on produit – un flux). Donc pas de radio dite « de rattrapage » (un flux FM découpé a posteriori en multiples fichiers numériques), ni des programmes non téléchargeables, payants ou uniques – toutes choses que l’on rencontre aujourd’hui couramment sous l’intitulé de « podcast », mais qui dans la première période, celle du début des années 2000, se montraient plus rares9. Cette description, en raison même de son caractère restrictif, s’inscrit dans une philosophie utopique et généreuse, celle d’Internet comme d’un espace de partage, de libre expression, de gratuité, d’abondance et d’horizontalité. L’époque était aux blogs, à l’autopublication et à l’autodiffusion10. Le RSS se voulait respectueux des internautes, ne les contraignant pas à créer un compte pour avoir accès à un contenu et leur permettant de suivre de façon autonome, avec les outils de leur choix, les activités d’un site. Le podcast d’alors (et l’une de ses branches toujours aujourd’hui) se revendiquait ainsi comme l’adversaire du broadcast : une profusion de productions sonores réalisées avec les moyens du bord par des amatrices et amateurs passionnés, s’adressant à des publics très variés et prenant de multiples formes, à l’inverse de la programmation des antennes nationales, centralisée, réalisée par quelques personnes triées sur le volet et extrêmement normée. Une opposition web / hertzien qui permettait d’affirmer l’émergence d’une culture distincte du son, avec ses propres références, son ton singulier, ses codes originaux.
Le podcast contre la radio ?
Tempérons d’emblée cet antagonisme supposé entre podcast et broadcast, exagéré dès l’origine pour vanter la révolution en cours et qui ajoute beaucoup de confusion. Le podcast est bel et bien du broadcast, mais ce n’est pas grave – et ça pourrait même être une bonne nouvelle pour lui. Pour commencer, comme le signalaient dès 2005 des chercheurs et chercheuse en études sonores dans un article intitulé « La politique du podcast » : « Au-delà de son “techno-utopisme” convenu, l’argument du podcast-comme-libération charrie au passage son lot de contre-culture d’entreprise, participant de l’idée très subtile que certains produits des multinationales (un ordinateur, un Ipod) pourraient nous libérer de tous les autres11. » Le podcast demeure imbriqué dans une histoire institutionnelle et industrielle qui n’a rien d’alternatif, celle des télécommunications, d’Internet et des technologies audio. Pour faire un sort à la nouveauté ultime que constituerait l’écoute de programmes sonores par téléphone, précisons que la pratique remonte au 19ème siècle et représente même l’une des premières fonctions de l’appareil (certes fixe et non smart à l’époque). En 1881, onze petites années après l’invention de ce dernier, le français Clément Ader imagina ainsi d’y proposer, moyennant finances, le Théâtrophone, une retransmission en direct de pièces de théâtre ou d’opéras – Victor Hugo et Marcel Proust comptèrent parmi les abonné·es de ce « téléphone de loisirs » ou « d’agrément », selon les expressions de l’époque. Les informations ne furent pas longtemps de reste, puisque Tivadar Puskás lança dès 1893 à Budapest un « journal téléphonique », le Telefon Hírmondó. Les ancêtres de Spotify et Deezer arrivèrent une dizaine d’années plus tard, qui offraient, sous le nom de Tel-Musici et Magnaphone, un service musical. Pendant ce temps-là, la radio servait de moyen de communication interpersonnel – il faudrait attendre la fin des années 1920 pour qu’elle se fixe dans son rôle actuel de diffuseuse centralisée et qu’elle éclipse, par la même occasion, les usages précédents, protéiformes et parcellaires.

Réclame pour le Théâtrophone, issue du site de l’association La Régie théâtrale.
L’avènement de la radio en tant qu’institution n’empêcha pas, cependant, le développement simultané d’une utilisation amatrice (certaines bandes de fréquences se voyant officiellement réservées à des particulier·es dès le début du 20ème siècle et de la TSF), voire pirate : « À la mi-février 1923, un émetteur qui semble puissant et qui diffuse des bruits bizarres se fait entendre sur la région parisienne. Il couvre parfois les émissions de la Tour Eiffel et de Radiola en diffusant des bruits, des imitations de cris d’animaux, des airs chantés en direct ou des disques. Il ne donne pas d’indicatif. La presse qui découvre cette histoire à la mi-mars le nomme donc le poste zéro comme on appelait les stations d’écoute des conversations ennemies pendant la Grande Guerre12. » Le mystérieux flibustier s’avéra être un employé du laboratoire des essais de la Société Française Radioélectrique, fabricante des postes récepteurs Radiola et détentrice de la station privée éponyme. Reginald Gouraud, un ancien ambulancier étatsunien resté vivre en France après la guerre, diffusait sans demander la permission à quiconque et auprès d’un public impromptu sa programmation toute personnelle à des fins d’expérimentation – et devenait ce faisant l’un des multiples arrières-arrières-grands-parents du podcast.
GRAND JEU !
Sauras-tu distinguer le podcast indépendant et la radio associative ?
(en te bouchant les oreilles lors des indicatifs)
Ensuite, non seulement le terme principal pour qualifier la mise en ligne de programmes audio se trouve de facto constitué pour moitié de broadcast, mais l’objectif même de diffuser en masse se voit rarement remis en question – y compris parmi les amatrices et amateurs financièrement désintéressé·es, qui utilisent régulièrement les mêmes plateformes privées13 et les mêmes réseaux sociaux que les gros fournisseurs pour rendre leurs programmes les plus audibles possibles. Même si l’égalité en termes de rayonnement demeure toute relative, on ne saurait reprocher aux autrices et auteurs d’espérer être écouté·es. Or cette ouverture qu’a représenté et que représente toujours le podcast en termes d’accès à la parole, de contenus, de formats, de pôles de diffusion trouve un précédent dans le broadcast lui-même et plus précisément dans l’une des modalités très diverses qu’il a prises au fil du temps : les radios locales, communautaires, associatives. Leur émergence, d’abord sous forme pirate dans les années 1960 puis de façon institutionnalisée dans les années 1980 (pour nous en tenir à la chronologie française), fut le résultat d’une longue lutte pour redéfinir la diffusion hertzienne et a permis l’arrivée de voix, de cultures, d’idées, de musiques, de pratiques, qui n’avaient jusque là pas droit de cité sur les ondes. L’enthousiasme qui irrigue en ce moment les productrices et producteurs audio n’est pas sans rappeler cet immense espoir suscité par les radios libres. Si le podcast, non tenu par une grille et plus récent, a indéniablement introduit une grande variété de formats et des nouvelles narrations, des liens de parenté frappants apparaissent dans la façon de penser et de fabriquer le son dans les antiques associatives et les podcasts dernier cri : spécialisés sur des thématiques peu traitées dans les médias dominants, les programmes sont animés avec les moyens du bord et une grande liberté de ton par des équipes souvent constituées de façon affinitaire, qui se sont auto-formées et qui n’appartiennent pas à une génération plutôt qu’à une autre. Est-il donc pertinent de réduire Easy Rider (Radio PFM), qui approche des 1400 émissions, et 2h de perdues (Fréquence moderne), qui vient de dépasser les 80, à leurs marqueurs de la radio et du web, sans entendre tout ce qui les relie14 ? Étrangement, pourtant, aucun lien ou presque, à l’heure actuelle, entre le podcast indépendant et les radios associatives non commerciales, qui se méconnaissent mutuellement. Un morcellement en chapelles distinctes du petit monde du son en France qui ne s’arrête pas là, comme nous le verrons.
Notons au passage que la radio dite « de rattrapage », payante ou gratuite, a précédé bien des podcasts appelés « natifs », payants ou gratuits, aussi bien aux États-Unis qu’en France. Outre-Atlantique, l’une des premières sociétés à investir commercialement dans le domaine du son sur le web fut Audible, fabricante étatsunienne d’un lecteur audio portatif en 1995, puis à partir de 1998 vendeuse en ligne de contenus sonores pour le remplir, rachetée treize ans plus tard par Amazon et qui, n’ayant donc pas plus de doute sur sa légitimité que sur sa position ultra-dominante, sème aujourd’hui sa publicité à tout vent dans les podcasts, jusque sur France Culture15. Dès 1998, Audible se vantait ainsi de proposer, dans son format propriétaire .aa, « des milliers de programmes sonores parlés, allant de best-sellers de littérature audio jusqu’à des conférences de business innovantes, de cours magistraux de professeurs d’Harvard jusqu’à la dernière édition de Marketplace [une émission du service public radiophonique APM], des X-Files à Fresh Air et Car Talk [deux émissions du service public radiophonique NPR], de Bill Gates à Dave Barry, de Dante à Dilbert, et bien davantage »16.
Si la mise à disposition massive de son, notamment autre que musical, sur Internet relevait indéniablement de la nouveauté, l’entreprise ne faisait là que poursuivre sur support numérique un usage bien établi de commercialisation de programmes radiophoniques choisis, auparavant édités sur support CD, cassette ou vinyle, nous y reviendrons. Elle n’arriverait sur le web français qu’en 200417, laissant aux radios associatives non commerciales d’ici leur rôle de défricheuses altruistes. Avec des moyens quasi inexistants et des objectifs pour le moins différents, l’émission de musiques expérimentales Epsilonia de Radio Libertaire lança en effet en 2001 son site dédié (et, cela va sans dire, totalement gratuit), avec de premières émissions au format .ram, et en 2002, l’une des toutes premières radios libres françaises, Radio Campus Lille, proposait des archives à écouter sur Internet pendant un mois18 – sans plan communication ni département des nouveaux médias, et avec trois ou quatre ans d’avance sur les radios nationales. Au fond, l’ébullition que vit aujourd’hui le monde du podcast signerait peut-être bien sa reconnaissance, au bout de vingt ans, comme une forme de broadcast à part entière : le podcast est en train d’obliger le broadcast à se recomposer une nouvelle fois et de s’y faire une place officielle.
Cette recomposition est par ailleurs largement rendue possible par la rupture d’une frange de la diffusion de masse à l’ancienne, journalistes de grands titres ou anciennes productrices et producteurs d’antennes nationales, qui connaissent les limites du fonctionnement des grosses structures et veulent s’en affranchir. Parmi les stars que le milieu podcastique s’est fabriquées (une habitude éminemment broadcastique), une bonne part viennent en effet précisément de la radio hertzienne et des médias de masse, aux États-Unis comme en France. Deux des trois « podfathers » outre-Atlantique, aussi bien que les têtes d’affiche actuelles : Ira Glass de This American Life, Sarah Koenig de Serial ou encore Alex Blumberg de Gimlet Media, pour n’évoquer qu’eux et elle. En France, la pionnière et référence incontestée, Arte Radio, émane d’une chaîne de télévision publique, qui diversifia ainsi ses productions en investissant le web de façon inventive. En 2003, bien avant que Radio France ne se lance dans la « radio de rattrapage », un auditeur de l’émission de Daniel Mermet sur France Inter mit quant à lui à disposition de façon « non officielle » toutes les archives de Là-bas si j’y suis sur le site la-bas.org. L’outil du podcast se voyait alors employé pour constituer une sonothèque spontanée, publique et permanente, d’un programme de broadcast portant des voix minoritaires. Lorsque le producteur fut évincé de l’antenne en 2014, c’est sur ce site, entièrement refondu, qu’il trouva refuge pour poursuivre son travail de manière indépendante, en instituant un abonnement afin de rendre l’activité économiquement viable19 et en développant d’autres contenus (vidéos, textes, dessins).
« Video Killed the Radio Star » (The Buggles, 1979)
Ah non, c’était le podcast en fait (Quenton & Phil_Goud, 2015)
Une démarche similaire, rentabilisation en moins, à celle qu’avait déjà menée le journaliste Serge Fournel en 2006, en lançant le podcast Oh la radio ! : « Comme métier, je “fais” radio. J’ai navigué à Radio France, France Inter et RTL. N’ayant actuellement ni vaisseau ni paquebot, je communiquerai avec vous gaiement ici grâce aux merveilles de la podcasterie depuis mon sublime studio perso non loin des bords de Loire20. » Aujourd’hui, parmi les nouveaux producteurs et productrices qui cherchent à professionnaliser et à faire fructifier financièrement la pratique en France, beaucoup continuent à venir, précisément, des antennes nationales ou de groupes de presse21. Le podcast a offert, dès le départ, des possibilités d’expression et de diffusion inédites, ce qui ne l’empêche pas de demeurer profondément lié à l’histoire de la radio hertzienne et des médias de masse : il les questionne, certes, mais, tout autant, les poursuit, se les approprie, en exporte les savoirs comme les pratiques, et les renouvelle.
Intermède sonore
Pour patienter avant la mise en ligne la semaine prochaine de la deuxième partie de cet article, voici
« la fameuse histoire du podcasting que seul·es les initié·es chamanes connaissent »
par Louna Noname dans son podcast Joyeux bordel, le 24 juin 2006 :
À lire sur Syntone :
- La deuxième partie de cette histoire du podcast, « Un terrain vague inépuisable », et la troisième, « Des cabanes aux immeubles ».
- Une réflexion sur les nouvelles narrations liées au podcast : « Quelles histoires nous raconte le storytelling ? »
- Notre dossier pour les 10 ans d’Arte Radio, en 2012.
- Notre veille sur des émissions de radios associatives ou publiques et les podcasts : tag émissions & podcasts.
Notes :
1 Ce mp3 inaugural se trouve ici. 2 Les entretiens menés par Lydon sont toujours en ligne. 3 Un épisode du mois d’août 2004 est par exemple audible sur l’Internet Archive. 4 Ben Hammersley, « Audible revolution », The Guardian, 12 février 2004. 5 On notera néanmoins qu’Arte Radio a consacré le terme d’ »audioblog » en baptisant ainsi sa plateforme d’autopublication gratuite, créée en 2006. Il avait, auparavant, été notamment employé en 2005 par le podcasteur Luc Saint-Elie dans le « carnet de notes » musical qu’il proposait sur son site audioblog.fr. 6 Jason Calacanis, « Apple to trademark Podcast? (or “How to fight the good fight”) », calacanis.com, 23 septembre 2006. Précisons qu’Apple a cependant réussi, à la même époque, à faire interdire l’utilisation commerciale du mot « pod » (qui signifie « cosse » dans le langage courant) par d’autres sociétés qu’elle-même dans un contexte technologique. 7 Communiqué de presse d’Apple le 28 juin 2005. 8 D’autres y avaient remédié avant Google, comme podcastre.org, listennotes.com, fluiddata.com ou matoola.com. 9 Les podcasts vidéo semblent avoir suivi l’évolution inverse : présents dans les années 2000, quoique de façon secondaire (le podcast qualifiant essentiellement un contenu audio), ils n’existent plus qu’à la marge aujourd’hui, les plateformes centralisées comme Youtube, Dailymotion ou Vimeo ayant capté l’essentiel des contenus. 10 Voir à ce propos l’histoire du web synthétisée par Olivier Ertzscheid dans « Internet a permis au peuple d’écrire (en prison) », 21 février 2018. 11 Michael Brendan Baker, Jonathan Sterne, Jeremy Morris et Ariana Moscote Freire, « The Politics of Podcasting », 2008, Faculty Publications and Scholarship, School of Communication and Literary Studies, Sheridan College. J’ai traduit par « techno-utopisme », plus employé aujourd’hui, l’expression originale de « Californian ideology ». Cette dernière fait référence à un livre éponyme publié en 1995 par Richard Barbrook et Andy Camero, où se voit critiquée l’idée, entretenue à droite comme à gauche, selon laquelle les technologies produites par la Silicon Valley seraient intrinsèquement vectrices de démocratie et de progrès. 12 « À la recherche du poste zéro, la première “radio pirate” parisienne », radiotsf.fr, 25 avril 2018. 13 Une même émission peut ainsi se voir diffusée sous de multiples formes et en conjugue souvent plusieurs : en mp3 dans un flux RSS auto-hébergé ou fourni par exemple par un agrégateur comme Podcloud (proche du podcast indépendant) ; en lecture seule (streaming) à travers un lecteur audio autonome ou, plus fréquemment, sur des plateformes privées et des applications mobiles comme Itunes (la base sonore de référence, dont le classement interne se voit, de façon assez consternante, érigé au rang de mesure officielle des écoutes), Pocket Cast (tout juste rachetée par les quatre plus gros fournisseurs de podcasts étatsuniens), Soundcloud, Mixcloud, Bandcamp, Pippa, Spotify, Deezer, Stitcher et même Youtube, où l’on trouve paradoxalement de nombreux contenus audio ; et, depuis peu en France, à travers des enceintes connectées qui iront piocher dans l’un ou l’autre fonds de podcasts en fonction des intérêts commerciaux de leurs propriétaires (Amazon, Google, Apple et autres géants de l’Internet). On peut d’autant plus regretter la captation ainsi opérée de bon nombre de contenus audio par des banques de son centralisées que dans le domaine audiovisuel, ce phénomène a largement contribué au tarissement du podcast vidéo. 14 Et l’on pourrait décliner longuement ces tandems. Histoires de terre (Radio Vassivière) et Bons plants (Binge Audio) n’offrent-elles pas des perspectives éminemment complémentaires ? Salle 101 (Fréquence Paris Plurielle), qui met son émission hebdomadaire en ligne depuis 2003, ou Radio Grand Papier (Radio Campus Bruxelles) seraient-elles moins modernes que Comics Outcast (Radio Kawa) ou L’école des FAQ (indépendant) ? Les publics de La Vaina (Radio Vassivière) ou d’Opération Kangourou (Radio MNE) et celui de Version standard (indépendant) ne peuvent-ils pas se recouper ? Côté veille sur les nouvelles technologies, vous avez depuis longtemps le choix, selon votre culture politique, entre Les Amis d’Orwell (Radio Libertaire), qui existe depuis 2006, et Studio 404 (Qualiter), fondé en 2012. 15 Lire à ce propos « Bruno Denaes et Serge Schick, parrains de la publicité sur Radio France » de Denis Souchon sur Acrimed le 27 mars 2018. 16 Voir la première archive du site d’Audible consultable sur l’Internet Archive. 17 Voir la première archive du site français d’Audible en février 2004, encore « en construction » mais avec un nom de domaine réservé. 18 Et encore : il est très probable que d’autres radios ou émissions de radio aient mis du son en ligne avant cela. Avis de concours dans les commentaires ! Nous offrons le n°14 de notre Revue de l’écoute à celle ou celui qui trouvera la plus ancienne et en fournira le lien (via la Wayback Machine de l’Internet Archive par exemple) ou autre preuve irréfutable. 19 Les archives de 2002 à 2014 demeurant naturellement en accès libre. À noter qu’il existait en 2003 un deuxième site mettant à disposition les archives de Là-bas si j’y suis : lbsjs.free.fr. 20 Serge Fournel, « Rire! Rire! Rire! Il faut savoir être bête et content! », ohlaradio.com, 2 octobre 2006. 21 Binge Audio a été fondé par un ancien du service Nouveaux médias de Radio France, Joël Ronez ; Louie Media, par des journalistes de Slate, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua ; Riviera Feraille, par le chroniqueur multicartes Henry Michel (Slate, Arte, Libération, Vice…) ; Nouvelles écoutes, par les journalistes Lauren Bastide (Elle, Canal+) et Julien Neuville (Le Monde, L’Équipe, Elle); Édouard Zambeaux, après l’éviction de son émission Périphéries de France Inter, l’a poursuivie sous le même titre sur le web ; Philippe Meyer, après que L’Esprit public soit sorti de la grille de France Culture, a créé Le Nouvel esprit public en ligne… la liste pourrait se poursuivre longuement.
